Le pétard ne fait plus effet. La montée est rude et la descente souvent ennuyeuse. Je n’arrete pas de penser à la minette de l’autre soir. Et il en faut pas beaucoup pour que quelques larmes essaient de franchir ma virilité à deux balles. Il fut un temps où longer les quais du Vieux Port suffisait à chasser les mauvaises images qui hantent mon esprit. Supporter l’immense nuit. Pas ce soir. Il est presque minuit et j’ai un mauvais air de jazz qui me trotte dans la tête. Ce soir la mort m’accompagne. Elle se délecte de mon inquiétude éternelle. Ce soir elle ouvre la marche.
Ça va faire une heure que je glande autour de cette rue à oublier de me demander comment j’en suis arrivé là. 24… 26… 28. C’est là. 30… encore un tour. Quelques gouttes. Je m’abrite sous le parvis d’un kébab pour m’allumer une Gitane. Putain, j’ai les boules. Il doit avoir de bonnes raisons pour me faire venir ici. Je remonte la rue. 37… 35… J’aime pas ce quartier. Un ramassis de clodos shooté jusqu’aux yeux qui n’arrivent même plus à m’émouvoir.
Je sonne. J’attends. Je sonne. Personne. La porte est entrouverte. Je fouille dans ma poche. Vieux réflexe. Quelques pièces, pas d’arme. La baraque est vide. Je vais me poser et l’attendre, sagement. Il doit avoir de bonnes raisons. De toute façon j’aurai beau dire que j’y suis pour rien, je morflerais quand même.
Merde ! Il fait noir. Impossible de trouver l’interrupteur. Je tâtonne. Je cogne des cartons, des cannettes. Et ça pue. Une vraie décharge. Je me glisse vers le canapé, je vais l’attendre là. J’aurai au moins l’effet de surprise pour moi. C’est con je me serais bien servi un verre. Au lieu de ça je me rallume une clope.
J’ai pas tout de suite saisi la silhouette lorsque la flamme du briquet a discrètement éclairée la pièce. Mais j’ai compris. Je n’avais pas fait attention au petit grincement en entrant mais maintenant je l’associe à ce que je viens de voir. Je n’ose pas rallumer le briquet. Un manque de curiosité malsaine.
C’est lui. Il se balance au bout d’une corde habilement attachée sur une de ses poutres apparentes. Je le reconnais au pendentif corail et or qu’il a autour de cou.
J’en ai trop vu dans ma vie pour sortir en courant et pour vomir au coin d’une rue. Pourtant j’ai la nausée. Le temps est glacial. Le vent accompagne la douce pluie. L’air impur de Marseille s’étouffe dans mes poumons trop pressés de s’essouffler. C’est de l’odeur dont j’ai du mal à me défaire. Une veille odeur de pisse.
Je suis assis comme un con sur le trottoir. J’essaie de comprendre mais ça vient pas. Dans quelle merde je me suis mis. Et pourquoi lui. Il n’avait rien à voir dans tout ça. Je ne crois plus aux coïncidences. Qu’est qu’il est allé foutre avec ces types ? Et pourquoi il m’a demandé de venir ce soir ?
L’idée de rentrer chez moi ne me plait pas trop. Le courage me manque. Une route s’ouvre à moi. Lucie. Le bar des maraichers.
Le bar est plein. Brassens s’amuse à dire qu’il est de la mauvaise herbe et moi je me demande à qui ça dérange que je vive un peu. Elle est où ma vie ? La réponse est facile quand on a passé le quart de sa vie en taule. J’ingurgite un verre fraichement servi et mon impatience fait tourner machinalement mon paquet de clope sur lui-même. Et je pense.
Je pense à Gros Louis. A Fred. Au corse. Et à Polo qui ne fera plus chier personne avec ses histoires de dope.
De toute façon, il va falloir que j’affronte Gros Louis.
*
Lucie ?
Elle vient d’entrer. Elle ne souri pas et pourtant son visage illumine. Lucie est une de ces filles dont la présence rassure. Etrangement, il me plait à dire qu’elle incarne le bien-être, la sérénité. Et pourtant, aujourd’hui, quelque chose s’est cassé dans son sourire. J’ai brisé sa douceur. Son calme s’est effrité. Depuis que je l’ai rencontrée, j’ai l’impression de l’avoir usée, utilisée, détruite petits bouts par petits bouts. Et aujourd’hui je risque de l’achever. Et elle le sait. Et pourtant son visage illumine.
- Ca va ?
- … J’ai pas beaucoup de temps. Qu’est-ce que tu veux ?
- C’est Polo ! Je… il s’est… enfin j’en sais rien.
- …
- Il est mort. Je l’ai trouvé tout à l’heure pendu chez lui.
*
Je suis allongé sur le dos. On ne dort pas. On se tait, aussi discrètement que possible. Je pense sans savoir à quoi. Je me perds dans sa respiration. Elle a la tête posée sur mon épaule comme pour se blottir contre moi. Mais c’est elle qui me protège. Et elle le sait.
- Tu veux m’en parler ?
- Non.
Pour lui dire quoi. Porter le coup de grâce ? Une bonne occasion de me virer de chez elle une bonne fois pour toute ?
Elle n’est pas allée à son rendez-vous, hier soir. Comme d’habitude je suis venu gâcher cette soirée qui aurait pu la sortir de ma vie. Non. Au lieu de ça elle est allée pleurer secrètement dans mes bras. Au lieu de ça je me suis abandonné lâchement dans les siens.
- Tu viens, tu tires ton coup, tu bois ton café et tu te casses. Ça te fais pas chier de savoir que je suis là, devant toi à espérer quelque chose. J’en ai marre de n’avoir que les miettes.
Même sa colère est douce. Et j’ai honte. A bien y réfléchir, elle avait raison. Et après tout ce qu’il venait de se passer, j’avais encore le culot de venir la chercher.
Elle est belle, Lucie. Dans d’autres circonstances je pourrais lui dire que je l’aime. Mais c’est plus possible. Je ne sais pas aimer. Du moins pas avec ce qui est arrivé ce soir. Parce que c’est elle qu’on va retrouver pendue ou égorgée dans un coin.
Jusqu’à présent, Lucie, c’était la seule qui ne posait pas de question.
*
Un qui risque d’en poser, des questions, c’est gros Louis. Et là, j’ai intérêt de trouver des réponses.
Elle me manque.
- Faut que je te parle.
Le gout du café n’est plus le même. Le gout de sa chair, indifférent. Le désir est parti.
- Lucie…
Qu’attends-tu de moi ?
Pourquoi tu me jettes pas.
- Faudra qu’on se voie plus pendant un certain temps.
- D’accord.
Etrangement, j’attendais une autre réaction.
La journée va être difficile. Lucie n’est pas allée travailler. Moi non plus d’ailleurs.
- Raconte…
- Viens, on descend boire un café et je te raconte tout.
J’ai fouillé dans la poche de ma veste pour en sortir mon paquet de Gitanes. Tu vas tout lui dire. C’est quoi le but. Qu’elle te déteste. Qu’elle parte loin de toi. Tu veux la sauver ? De qui ? D’eux ou de toi ? Elle n’est rien pour toi. Rien à côté de ce que tu as perdu. Et aujourd’hui t’as plus rien à perdre.
- Faut que je te raconte tout depuis le début…
Ça faisait que quelques semaines que j’étais sorti de taule. J’avais trouvé un boulot de merde dans un supermarché, remplir les rayons. Une espèce de reconditionnement à la vie sociale. C’est comme ça qu’ils appellent le fait de se faire exploiter par une bande de jeunes cons tout juste sortis de leurs écoles de commerce et qui se donnent le droit de vous traiter comme des sous-merdes. Des chefs de rayons qui assouvissent leurs complexes de supériorité sur des anciens détenus. Et Dieu sait que je ne supportais pas ça. J’avais fêté mes trente ans aux Baumettes. J’avais pris dix ans. Pour braquage. Libéré pour bonne conduite au bout de sept. Et j’avais pas forcément envie d’y retourner.
C’est le vieil Antoine qui a out déclenché. Le jour de ma libération. Antoine, c’est un des rares qui n’oublie pas les copains.
- Toi et le petit Christophe, vous étiez pas mal partis. Mais les flics, tu le sais, ils s’énervent facilement. C’est pas ta faute ce qui est arrivé. Un coup de malchance. Té ! la semaine dernière, c’est le neveu d’Emile qui s’est fait tirer comme un lapin. Deux balles dans le dos. Légitime défense. Même pas armé.
- C’est gentil d’être passé me voir.
- Elles t’ont plu les confitures. C’est Célou qui les faisait en essayant d’y mettre tout le soleil que tu pouvais pas avoir. Tu la connais, elle supporte pas de voir quelqu’un en cage. Alors toi… tu sais, elle t’aime bien.
- Je sais, Toinou. Tes lettres et les douceurs de ta femme, c’est un peu ça qui m’a fait tenir.
Mais Antoine, je le connais. Rien n’est gratuit. Rien ne se fait par hasard.
- Tu te souviens du vieux Santini.
- Bien sûr. Mon père, quand j’étais pas sage, petit, il me disait, si tu continu, je te donne au Gros Louis. Et ça me calmait direct.
- Souvent il me demandait comment tu allais. Tu sais que c’est le cousin de la mère à Christophe. Et comme t’es sorti, il voulait savoir ce que tu faisais.
- Je viens juste de sortir, Toinou.
- Je sais, c’est ce que je lui ai dit. Mais il se demande, par rapport à sa cousine. Enfin, il a souvent besoin de gars comme toi. Pas casse couille, un peu débrouillard. Discret et pas trop con. Où tu crèches en ce moment ?
- A la maison de mon père. Derrière le port, tu sais…
- Et comme, bien sûr que je sais, c’est même moi qui l’ait trouvé cette maison à ton père. Que le dimanche on se faisait des parties de boules que ton père il se mettait dans une colère, que même ta mère, elle arrivait pas à le calmer.
Des histoires comme ça avec mon père, j’en ai entendu tellement que je pourrais écrire un livre. Mais moi j’ai jamais vécu ça. Mon père, il se levait le matin et il était déjà bourré. Et quand c’était pas sur ma mère qu’il s’acharnait, c’était sur ma sœur. Moi, il m’a jamais touché. Et j’ai jamais rien vu. Du moins j’ai jamais voulu voir. De peur que ça change. Moi, j’étais le garçon. Celui qu’on met dans les bons coups. Celui qu’on amène à la chasse, et puis voir les copains. Des copains comme Louis Santini.
- Et comment elle va, la pitchoun ?
- Je… je sais pas. Quand ils m’ont serré, Marie, elle est partie avec la petite. Et depuis j’ai plus de nouvelle. J’ai même pas le droit d’aller la voir. C’est à cause de l’avocat. Il veut pas.
- Prends le temps. Viens me voir. Quand t’en auras marre d’entasser des boites de conserve.
En sept ans, il en avait fait du chemin, le vieil Antoine. Quand mon père l’a connu, il était agent immobilier. Un véritable escroc. Son truc, c’était d’acheter une maison, sur Cassis, Gémenos, ou la Bouilladisse, du standing, et de la revendre à plusieurs personnes. Il mettait le fric de côté, il partait en taule, deux ans, maxi, et il sortait au bout de huit mois. Et il entretenait sa famille comme ça. Et personne ne se demandait pourquoi leur père ou leur grand-père passait autant de temps en zonzon qu’à la maison.
Mais depuis que Santini était devenu le grand patron, Antoine, il bossait que pour lui. De l’organisation. C’était un peu son affaire le placement. De la gestion de personnel. Puis au fur et à mesure, ça l’a placé au premier rang. C’était un homme de confiance. Un grand oncle qui prend soin de tous ses petits neveux.
*
La première fois que j’avais vu Louis Santini, c’était avec mon père. Un dimanche. J’avais treize ans. Et déjà, il me faisait peur. Il l’avait pas volé son surnom de Gros Louis. Mais dans la bouche de ceux qui l’appelaient comme ça, ça avait plutôt intérêt d’être respectueux. Parce que Santini c’était le genre de mec qui était capable de dessouder un mec et passer à table juste derrière. Personne ne sait vraiment d’où il vient. Certains disent qu’il est sarde. D’autres, napolitain. Mais ceux-là ne sont plus là pour le dire. Lui, il se prétend corse. Indépendant. Libre. De ceux qui disent que le corse, quand il veut quelque chose, il le demande pas. Il le prend.
Et c’est ce qu’il a fait. Il a prit le pouvoir sur Marseille. Ce qu’on sait c’est que la pègre était menée par Albert Castiani. Et c’est Castiani qui a sorti Santini de la rue. Qui a fait de lui ce qu’il est aujourd’hui.
Si vous parlez de Marseille à quelqu’un qui ne connait pas, il vous dira que c’est la ville la plus sale de France, qu’elle est remplie de mafieux et de racailles. Et que c’est la pègre qui la dirige. Et c’est peut-être pas faux. Et ça n’a jamais été aussi vrai qu’à l’époque de Castiani. Marseille, c’était le Chicago français. Le respect des ainés. Les règlements de compte à la loyale. Des grands hommes qui règnent sur la ville d’une poigne de fer. De ceux qu’on voit jamais mais dont on entend tout le temps parler. De ceux qu’on craint.
Dans ce milieu là, on attribue toujours des surnoms. Celui du Santini, c’était le sourd. Mais jamais devant lui. Un peu parce qu’il avait perdu l’usage de son oreille droite lors d’un attentat à la plaine mais parce qu’on ne lui parlait jamais directement. Il fallait toujours passer par son bras droit. Et le jeune Santini avait bossé dur pour devenir cet intermédiaire. Il travaillait de plus en plus souvent pour lui, faisait des boulots de plus en plus sales. Quand on voyait débarquer le jeune Louis, c’est qu’il était déjà trop tard. Un qui avait trop de mois en retard. Un commerçant trop capricieux. Un rival trop présent ou trop bavard. Trop ambitieux.
Et un jour, le vieux Castiani est tombé malade. Il s’est résolu à passer le relais. Il disait qu’il n’avait plus assez de force pour gouverner une ville si pourrie qu’elle ne le respectait plus. Qu’il avait chopé la pire maladie qui soit. La peur. Celle qu’il avait redouté toute sa vie. La notion de respect dans ces milieux peut faire sourire. Mais il s’était toujours battu dans les règles de l’art. A la loyale. Et aujourd’hui, pour une simple dose, tu te fais flinguer par un gosse sur une moto au coin d’une rue. Sans personne pour venir pleurer sur ton cadavre. Et c’était ça que le sourd craignait. Que la mort le prenne au dépourvu.
Et c’est Santini qui est venu le chercher, un matin, dans son lit. Et le vieux le savait.
On a retrouvé Castiani une balle dans la tête et Santini à la tête de l’organisation.
*
Je me souviens de la fois où j’ai revu Santini. Antoine ne m’avait jamais lâché et malgré ce qu’il s’était passé, il avait toujours confiance en moi. La magouille et le banditisme, j’avais ça dans le sang. Antoine le savait et je n’avais pas envie de le décevoir.
Je n’avais jamais eu l’habitude de trainer dans des milieux aussi fermés. La truande, les braquages, ça oui, mais bosser avec des vrais bandits, j’avais jamais fait auparavant. Et pour être honnête, ça m’excitait.
J’ai revu Antoine peu de temps après notre discussion. Il m’attendait dans un piano-bar vers le Vieux Port, sur la place aux huiles, une de ces places où il fait bon de s’assoir au soleil pour déguster une bonne bouillabaisse pêchée du matin. On a bu un café en plaisantant sur les conneries que je faisais quand j’étais minot et en écoutant les histoires embellies d’Antoine qui semblait se souvenir des moindres détails de mon enfance, pour moi si lointaine.
Le train bleu. Sûrement en hommage à Coltrane, Santini l’avait renommé ainsi après la mort de Castiani. Le bar était vide. Un groupe de jazz se disputait quelques notes sous le regard interrogateur du barman, sceptique.
Quand la porte s’est refermée, tout le monde s’est retourné vers moi, sans faire attention à Antoine, comme s’il faisait parti des meubles. Mais personne n’a rien dit.
Le bassiste a lancé sa ligne de basse comme inspiré par mon entrée, en essayant de faire oublier mon intrusion. Et le pianiste a enchaîné, suivi de près pas le trompettiste et le batteur qui glissait ses ballets sur les parois de son fût.
- Viens, c’est par là.
J’ai suivi Antoine au fond de la salle.
- Monsieur Santini ?
- Antoine… Approche.
- J’ai aperçu une masse imposante, cachée derrière un immense nuage de fumée provenant d’un cigare tout aussi majestueux. Il ne m’a même pas regardé. Il a juste dit de sa voix caverneuse noircie par l’alcool et le tabac : Avance !
Ce mec là avait beau être gros à en crever, il n’en imposait pas moins le respect. Son volume symbolisait sa puissance.
- Monsieur Santini, merci de me…
- Arrête d’essayer de me lécher le cul, gamin, j’ai horreur de ça. Tu cherches du boulot et Tony me dit que t’es un gars sérieux. Sans lui je t’aurai déjà foutu dehors. En plus, t’as une sorte de dette de famille, si tu vois ce que je veux dire. Alors si t’es là pour faire le con tu peux retourner faire le clodo dans ta pissotière. T’es là pour me faire chier ?
- Non, Monsieur… je…
- Très bien. Les p’tites merdeux dans ton genre, ils finissent au trou, rencontrent une ou deux pédales et pendant qu’ils se font enculer ils ont tendance à trop l’ouvrir. C’est ton cas ?
- Non, j’ai…
- Ta vie je m’en cogne. Si tu te fais coincer, je te laisserai pas ouvrir la bouche. Même pas pour me sucer.
J’étais terrifié. Le piano s’effaçait devant le son du cuivre qui inondait paisiblement la pièce. Je cherchais du réconfort dans les yeux d’Antoine, cet oncle aux souvenirs d’enfance. Mais il semblait les avoir égarés et pour la première fois j’ai eu la sensation qu’il m’abandonnait.
J’ai bossé cinq ans pour Gros Louis. A faire des boulots de merde. De la surveillance. Des messages à faire passer. Des commissions. Des services qu’on ne peut pas refuser. Et je suis rapidement passé au racket. Louis avait jugé que j’étais habille dans ce domaine. Comme une promotion.
Tous les jours, accompagné par quelques gars, je faisais la tournée des bars, des boîtes, des restaurants de Marseille. Tous payaient la protection de Santini. S’ils ne payaient pas, des vitrines volaient en éclat. Et s’ils ne payaient toujours pas, un malencontreux incendie pouvait ravager leur établissement en moins de temps qu’il nous fallait pour leur casser les genoux ou leur défoncer les dents à coup de batte de baseball. A la fin, tout le monde y allait de son porte-monnaie.
Et plus ça allait, plus on visitait de monde. Les sex-shops, les cinémas, les bijoutiers, même les navettes qui partent sur le château d’If et sur l’ile du Frioul. Tout l’univers Santini. Rien ne lui échappait. Un commerce se montait, il fallait l’accord de Gros Louis pour qu’il reste debout. Et nous on était les messagers de Dieu. Faut pas s’imaginer qu’on était plein aux as. On manquait juste de rien. On était bien, tout simplement.
Puis au fil des années, je suis passé à la surveillance du marché clandestin. L’esclavage. Des containers entiers remplis de main d’œuvre bon marché, à qui on ôte rapidement les rêves qu’ils ont dans la tête pour les entasser dans des caves humides. Ou encore des arrivages de filles de l’est, d’Asie ou du Maghreb. Des fillettes de quinze ans qui se retrouvent rapidement sur le trottoir et qui pour la plupart ne parlent même pas français.
Moi, chaque semaine, je devais rendre des comptes à Santini. J’étais assez bon pour ce job. Je faisais le tri entre la bonne et la mauvaise came. Je réglais les problèmes des mauvais payeurs. Les filles étaient bien traitées avec moi. Si elles ne déconnaient pas trop, je faisais l’impasse sur la dope et les passes clandestines. Et Louis, il aimait pas trop ça. Mais fallait se mettre à la place des filles. Ça devenait rapidement une nécessité de se camer pour mieux accepter leur condition de pute. Jusqu’au jour où la marchandise devenait trop avariée pour être consommée. Là, je ne pouvais plus rien pour elles et elles étaient vite remplacées.
Puis le marché a commencé à s’épuiser. Les macs indépendants ont fait leur apparition. La guerre des putes à débuté. On les retrouvait égorgée dans leurs piaules, violées, défigurées.
Et moi, je commençais à avoir des remords. Je faiblissais. A chaque nouvelle fille que je prenais, j’imaginais que dans le lot, y avais peut-être la mienne.
De son côté, Santini a commencé à s’intéresser de plus en plus à la blanche. Un trafic qui rapportait beaucoup plus.
- Toinou, je croyais qu’il voulait pas en entendre parler. Et aujourd’hui, y a pas un mec qui deale pas pour lui.
- Ses convictions tu peux te les mettre où je pense. Tu bosses pour lui. Tu changes juste de came. C’est tout.
- Et les filles ?
- Y a qu’à voir le bon côté des choses. Maintenant, c’est chez nous qu’elles se fournissent
Antoine le voyait bien que j’allais décrocher. Les filles, c’était comme une famille et c’était déjà assez dur. La dope, je pouvais pas.
- Tony…
- C’est une question de pouvoir. Pas de fric. S’il laisse passer, il ne fera plus le poids. Te fais pas de bile. Louis, il sait ce qu’il fait.
C’était pas pour lui que je m’en faisais.
- Je peux plus, Antoine. J’ai plus la hargne. Les gamines… c’est plus pour moi.
C’est à partir de ce moment où les choses ont commencé à changer.
- J’ai peut-être un job pour toi. Tranquille. Des vacances, en quelque sorte. Tu te souviens de la petite nièce de Santini ? Kaya ?
*
C’était il y a six mois environ. J’avais en effet l’impression d’être en vacance. De revivre. A côté de ça, je continuais les petits boulots pour Santini. Mais la plupart du temps, le job consistait à surveiller la gamine. J’avais tout prévu. Plus de pute, plus de dope. Un petit boulot tranquille, histoire de me laver le cerveau. J’avais même prévu d partir retrouver Marie, et la petite. Je voulais plus regarder ces minettes foutre leur vie ne l’air et j’avais envie de voir grandir ma gamine.
La seule chose que j’avais à faire, c’était de faire en sorte que tout se passe bien avec Kaya. Qu’elle fasse pas trop de connerie.
Je l’attendais tous les matins devant le bar L’imprévu, sous son appartement. Je me postais au café en face et j’attendais. Au début, je marchais derrière elle, je la suivais jusqu’au lycée Thiers, en bas du cours Julien, et puis j’attendais qu’elle sorte. Et je la raccompagnais chez elle. Et ça la faisait marrer d’avoir une sorte de garde du corps. C’était une gamine de dix-huit ans et moi, un vieux bandit de quarante. Mais j’ai commencé à tomber sous le charme de son sourire vicieux. Et elle a fini par m faire tourner en bourrique.
Elle a commencé à découcher. A dormir chez Mathieu Agostino, son mec du moment, et occasionnellement dealer de Gros Louis. Elle me fuyait. Elle partait plus tôt, me faisait poireauter des heures devant leur appartement. Le jeu de piste devenait de plus en plus dur et je la perdais sans cesse.
Un jour que je la cherchais depuis plusieurs heures, je l’ai surprise à genoux, dans la ruelle, derrière le lycée, en train de tailler une pipe à un mec assez vieux pour me filer la gerbe.
Elle m’a regardé, lâché son partenaire qui s’est mis à détaler en me voyant arriver et elle m’a sourit.
- Pourquoi tu fais ça ?
- Ça te fais bander de m’observer ? Je t’en donne pour ton argent.
Elle avait les yeux rougis par la honte et la fierté d’assumer ce qu’elle était.
- Je…
Et elle m’a craché au visage. J’ai empoigné son bras, je l’ai ramené vers moi comme pour lui foutre la raclée que j’aurai filé à ma propre fille.
- Tu veux me cogner, c’est ça ? Tu crois que t’es le premier ?
J’ai lâché son bras et je me suis essuyé avec le revers de ma manche. On est resté là, tous les deux, sans se regarder. J’ai ramassé son sac lorsqu’une voiture s’est arrêtée devant nous.
- Montez, tous les deux.
Louis Santini me faisait surveiller. Pourquoi ? Il avait eu vent de mon échec avec sa nièce. Peut-être même qu’il en savait plus que moi sur ce qu’elle faisait derrière mon dos.
Il avait envoyé ses chiens de garde nous récupérer. Le corse. Un petit brun, trapu, les yeux de glace. Un mec à qui il était difficile de refuser quoi que ce soit. J’ai jamais su son vrai nom. Et Fred, un nouveau. Le genre très blond.
On est monté à l’arrière de la voiture, direction l’Estaque.
L’Estaque, c’est un petit port de pêche typique au nord-ouest de Marseille qui sait si bien allier mer et collines provençales. L’été, on s’y pose tranquillement entre amis ou en famille dans un café et on y déguste quelques panisses ou chichi-frégis tout en regardant les joutes nautiques.
Sur le port, il y a toute une rangée de bar. C’est à la terrasse d’un de ces bars que Santini nous attendait.
Le corse a emmené Kaya au fond de la salle pendant que je m’approchais de la table de Santini.
- Je t’écoute.
- Louis… Monsieur Santini… je… elle…
Il fit un geste de la tête à Fred et l temps que je comprenne, j’avais mangé un direct dans le bide.
- C’est tout ce que t’as à dire ? T’es chargé de la surveiller et pendant ce temps la elle fait la pute derrière l’école…
- Monsieur Santini… elle me fuit.
- T’inquiète pas pour ça, elle va se tenir à carreaux. Je te le promets. Et toi, tu sais que je t’ai à l’œil. Si tu dérapes encore une fois, tu finiras dans le coffre d’une voiture, direction les Goudes. C’est pigé ?
- Oui, Monsieur Santini.
- Attends-moi dans la voiture.
Il s’est levé et s’est dirigé vers elle. Lorsque Kaya est entrée dans la voiture, elle portait les ecchymoses de son insouciance. Je regardais son visage abîmé par l’autorité. Gros Louis était sûr qu’après la rouste qu’elle s’était prise, plus jamais elle ne déconnerait.
Il se trompait.
Fred nous a ramené. Je suis descendu au Vieux Port. J’ai regardé Kaya à travers la vitre.
- A demain ?
La voiture a démarré en trombe et je les ai regardés remonter la Cannebière. Le Mistral soufflait et j’en avais besoin. J’’aurai voulu que ce vent efface le visage tuméfié de la gamine. Je voulais qu’il supprime la culpabilité qui me rongeait. J’étais pas seulement coupable des coups que ce gros tas lui avait asséné. J’étais coupable de l’affection que j’avais pour cette gamine.
Je crois que c’est à cause de ça que tout a dégénéré. La menace de son oncle avait fait effet. Kaya s’était calmée. Je venais la chercher devant son appartement, et je la ramenais. Le soir je la suivais sur la plaine, le cours Ju, le Vieux Port… et j’attendais.
Je la voyais sortir, s’amuser, picoler, se défoncer avec le petit Mathieu, et je ne disais rien. Tant qu’elle ne me fuyait pas, elle faisait ce qu’elle voulait.
*
Le soir, après l’avoir quittée, je traversais le cours Julien, suivi de près par quelques gamins qui animent les pontons de la fontaine et qui tentent de vous taxer une clope. Les rues sont bondées et pourtant, elles paraissent désertes. Dealers, glandeurs, loosers, bobos, rastas, joueurs de jumbé, la plupart, un pétard au coin du bec. Tous artistes, tous marginaux à leur manière. C’est au milieu de cette cohue qu’il m’arrive de cuver ma bière, ou de finir ma nuit. Ecoutant les fables d’un vieux sax rouillé qui s’époumone sur un vieil air de reggae ou déchiffrant les délires d’un poète black sur la nouvelle Babylone. Parfois, un cracheur de feu s’en mêle, et la dernière latte tirée sur un pétard qui n’en finit pas de tourner me chasse de ce monde que je n’arrive plus à vomir.
Ce soir là, j’ai trainé dans le quartier. J’ai bu et fumé toute la soirée. Et j’ai imaginé. Fantasmé. Me demandant qui était l’enfant de salaud qui la réconfortait. Qui était le mec qui embrassait sa jolie petite lèvre fendue par les mains cagneuses de son oncle. Mathieu Agostino. Petit revendeur de came. Je les ai imaginés baisant tous les deux dans la crasse et la sueur de leur dope mal coupée. Elle, suffocant derrière son souffle obscène. Ce que je voyais me rendait malade, jaloux à en crever. J’étais tombé amoureux d’une gamine.
Ce soir là, ivre de jalousie, je me suis posté devant l’appartement d’Agostino. Et j’ai attendu. J’ai attendu qu’elle monte, qu’elle descende, qu’il se pointe. Je scrutais les fenêtres dans l’attente d’une lueur, une lumière tamisée. Et je suis rentré chez moi.
Et le lendemain, comme tous les matins, je l’ai accompagnée.
*
Marseille. Ville de marins perdus et de cœurs brisés. Lorsque je la regardais arpenter ces rues, je pensais à ce que j’aurai pu devenir si le mauvais sort n’avait pas foutu la merde. Je me demandais s elle et moi, dans d’autres circonstances, nous aurions pu nous aimer. Je la suivais et je la regardais marcher. Son corps pourtant si frêle débordait de fierté et de sensualité. J’avais envie de l’enlacer, de l’enlever, de la baiser, de l’aimer, de la tuer si le destin oubliait de s’en mêler. A trop la suivre, j’en oubliais qui elle était. J’étais déconnecté de la réalité. Je buvais plus que de raison, je ne dormais plus, répétant les planques devant son appart ou celui d’Agostino. Je perdais pied. Ma vie c’était elle, Kaya, la nièce d’un parrain de la pègre marseillaise que je surveillais nuit et jour, que j’aimais, et qui me détestait.
Jusqu’à ce fameux soir de juillet.
C’était un de ces soirs, chauds, comme la cité phocéenne sait les choisir. Dans les rues, du Vieux Port à Castellane ou du Panier à la Plaine, les boulevards sont en fête et tout est prétexte pour s’amuser. Les arcs-en-ciel de filles se multiplient au fur et à mesure que les heures passent. Chaque bar est rempli de joie et de querelles, de vieux consommateurs de pastis ou de jeunes buveurs de bière. Chaque parcelle de chaque quartier nous chante une musique différente. Et dans ce monde nocturne ensoleillé, je la revois encore.
Je n’ai pas vu tout de suite son allure se dégrader, trop obnubilé par mes désirs. Ses yeux se ternissaient, son visage devenait blafard, se creusait d’avantage. Elle avait perdu son teint doré et sa vitalité. Elle paraissait désormais fragile, plutôt que frêle. Elle se camait. Agostino ne faisait pas que vendre sa dope, il lui en procurait aussi.
J’ai attendu qu’elle entre dans son appartement et je suis monté. J’ai sonné. Elle a ouvert la porte et s’est avachie sur le canapé.
- Tu veux quoi, bordel ?
Je me suis approché d’elle. Elle n’a même pas eu la force de se débattre lorsque je lui ai attrapé le bras.
- Ça fait longtemps ?
- Qu’est-ce ça peut te foutre ?
- Ton oncle, il sait ?
- Qu’il aille se faire enculer, lui et toi et tous ses fils de pute.
- C’est pour ça que t’es avec lui ? Tu baises avec lui pour la came ?
- Pourquoi, t’as un autre moyen ?
- Et tu crois qu’il va dire quoi quand il va savoir ?
- Je crois qu’il va te l’enfoncer bien profond. T’es pas censé me surveiller ?
- …
- Dégage de chez moi, connard !
J’ai regardé le taudis dans lequel elle vivait. Une boule se glissait lentement dans ma gorge. Je suis sorti en fermant doucement la porte pour me retrouver dans le noir absolue de la cage d’escalier et de mes fantasmes illusoires.
Les surveillances de nuit se répétaient, d’un endroit à un autre, tous aussi sordides, tous aussi glauques. J’avais décidé de la suivre de loin, de ne pas lui donner l’occasion de me provoquer. Mais je subissais son arrogance. Elle me narguait, dansait, se tortillait, se frottait à tout ce qui pouvait m’enrager. Elle buvait jusqu’à s’en rendre ridicule et j’éprouvais l’envie de rentrer dans son jeu.
Plus les soirées passaient, plus elles se ressemblaient. Ses amis et elle écumaient tous les bars qui se trouvaient dans leur passage. Toutes les boites qui les laissaient rentrer. La plupart du temps, ils finissaient au Pink Baby, un bar à pute dans le quartier de l’Opéra, où téquila, cocaïne et safe sex font un mélange détonnant. Devant la porte, il ya toujours un grand black qui garde l’entrée comme un rottweiler. J’ai jamais essayé de rentrer. Je m’installais sur le banc en face et je fumais clope sur clope en attendant que la princesse ait fini de s’envoyer en l’air. Et la soirée se finissait toujours sur mon épaule à vomir et à m’injurier jusqu’à son appartement où elle s’endormait les insultes à la bouche.
Mais pas ce soir-là.
El arenque ahumado café. C’est un bar à salsa que je pratiquais souvent quand les envies de meurtre et de sexe ne font plus qu’un. Au milieu de tout ce bruit, les cris et la musique cubaine se mêlent sueur poivrée, cigare et alcools forts. C’est le seul endroit où je me retrouve à chaque table. Les alcooliques n’ont pas de race et appartiennent à une seule famille, celle de la cause perdue, le désespoir. Ici tout le monde a un crime à confesser, une femme à oublier, une autre à aimer. Dans un sens, je n’étais pas surpris de la suivre ici. Elle symbolisait tout ça. L’envie, la sueur, le crime parfait.
Je l’ai regardée danser durant des heures, assit au comptoir à descendre rhums après rhums. Le bar était bondé mais je ne voyais qu’elle. Mon ivresse s’enlaçait autour de ses courbes androgynes et j’humais paisiblement ses épices corporelles. Plus elle tournait, plus elle m’enivrait de son parfum doucereux.
Elle a finit par s’approcher de moi, glissant sa bouche près de mon oreille pour me murmurer des bribes de phrases aromatisées que je n’ai pas saisi tout de suite. Je l’ai regardé, et elle n’a pas eu à se répéter. Elle a pris mon verre de rhum et l’a descendu d’une traite.
- T’as fini !
Ses mains se sont mises à parler le long de mon corps pendant que sa langue se promenait le long de mon cou. Elle avait les yeux luisant de désir et de cocaïne et la honte de profiter d’elle dans un moment de faiblesse se mélangeait au désir de la coucher par terre et de l’embrasser comme je l’avais si souvent imaginé.
- Viens ! On se tire d’ici.
On est sorti du bar, enivré, perdus, seuls. Elle m’a pris la main et s’est mise à courir. On a descendu le cours julien à toute allure. Je sentais mon cœur se déchirer et mes poumons s’enflammer. J’ai ralenti. Je l’ai retenu pour éviter qu’elle ne m’échappe. Elle a du marmonner quelque chose comme alors, le vieux, on a du mal à tenir la cadence ? Et sa phrase s’est terminée sur mes lèvres. Je ne tenais plus.
- Je crois qu’on va pas pouvoir aller chez moi. C’est loin chez toi ?
Je n’avais plus la force ni l’envie de répondre. Son appart, le mien… je me noyais dans mes fantasmes et je l’emportais avec moi. Alors chez elle ou chez moi. Le lieu du délit n’avait pas d’importance. En plus je ne voulais surtout pas savoir pourquoi son appart n’était pas disponible.
- La joliette. On va prendre un taxi !
Le taxi s’est garé en bas de mon immeuble. Elle me tenait par la main, comme on tient un petit garçon. Protectrice. Dominatrice. Égarée. Je ne voulais pas réfléchir à ce que j’étais en train de faire. Le moindre doute aurait tout stoppé. Et ça, il n’en était pas question.
La Joliette. Le quartier des dockers. J’ai un vieil appartement sur les quais, d’où on peut apercevoir, dès les premières lueurs du jour, des centaines d’hommes laissant filer une partie de leurs rêves avec les cargos qu’ils chargent et déchargent. C’est là que Christophe et moi on a gagné notre premier salaire. Les premières beuveries, les premiers shoots et les premières combines. On avait à peine dix-huit ans à l’époque et on fleuretait déjà avec des gros bras qui se régalaient à transformer les petits novices qu’on était en magouilleurs de quartier. L’endroit rêvé pour trafiquer et monter sa petite affaire à l’écart des curieux. De docker, on devient rapidement revendeur. Télés, parfums, montres, fringues, tout à portée de main, ou de camion. Les caisses disparaissent et s’éparpillent dans le petit Marseille. Et puis un jour, on fait une erreur, puis une autre, puis vient celle qui vous conduit directement en taule. Moi, j’y avais échappé. Un matin, lendemain de bringue qui s’était trop bien finie et j’avais oublié d’aller bosser. Mais pas Christophe, ni même les flics qui avaient eu vent qu’une partie de la cargaison du jour risquait de disparaitre. C’est comme ça que mon meilleur ami a fait son premier séjour à l’ombre.
La taule, avant ça, ça nous faisait marrer. On s’en fout d’y aller, on en reviendra plus fort. Le respect. La frime. On deviendrait des caïds aux yeux des potes. Sauf qu’une fois en taule, les potes changent. Et Christophe, lui, il avait remplacé ses potos de quartier par des mecs qui braquent dans la cours des grands. Nous, on y connaissait rien à la cambriole. Juste quelques trucs qui disparaissaient quand ça nous passait sous le nez. Rien à voir avec braquer un flingue sur la tempe d’un mec et d’y tirer tout son blé.
De mon côté, j’ai attendu qu’il sorte. Marie m’avait à l’œil. Edith était née. Je bossais pour nourrir la famille.
La première personne que j’ai vu mourir, c’était Christophe. J’aurai voulu qu’il me parle avant de mourir, mais quand il est tombé à mes pieds, il était déjà mort.
Sa femme, Sandrine, elle a craqué quand il a plongé. Elle lui a sorti son baratin de femme parfaite qui voulait un mari exemplaire, un modèle pour des enfants qu’il ne voulait pas avoir. Au lieu de ça, elle était maquée avec une racaille. Un gosse qui n’avait jamais arrêté de jouer au bandit. Six mois après notre sortie, il avait replongé pour deux ans. Trafic de fausse monnaie.
Un dimanche, après la visite hebdomadaire, Marie m’a regardé et elle a lancé :
- Tu sais, je serai pas aussi indulgente que Sandrine. Si tu replonges, c’est fini. Tu me vois plus.
Mais là-bas, Christophe avait rencontré les personnes qu’il fallait. Et dans le tas, Antoine. Un mec qui fréquentait trop souvent les lieux et qui commençait à se lasser. D’après lui, il avait quelques connaissances dans le milieu, qui nous mettraient sur des coups pas trop risqués. Quelques braquages.
- Tu le connais à peine.
- Il a l’air réglo. C’est du tout cuit son histoire. Attends que je te rencarde et tu verras.
- Je sais pas…
- Tout ce qu’il faut, c’est pas en parler aux filles. Elles comprendraient pas. On cherche du boulot… on leur fait croire… et hop ! on revient avec le pactole.
- T’as parlé d’un troisième larron ?
- Franckie. Il est cool. C’est Antoine qui l’a dit. T’inquiète.
On a débuté les casses avec un bar-tabac sur la Penne-sur-Huveaune, pas loin d’Aubagne. Franckie l’avait repéré depuis déjà quelques temps, mais tout seul, le coup était risqué. Il connaissait les habitudes des patrons pour la bonne raison que ces patrons-là, c’était les parents de son ex-femme. Il fallait y voir une vengeance personnelle. Le coup nous a rapporté assez pour nous faire oublier quelques semaines. Et puis on a recommencé. Plusieurs fois. Et au passage, le vieil Antoine prenait son pourcentage et tout le monde souriait à cette nouvelle vie. Mais Christophe en voulait plus. Il en avait marre de la petite monnaie.
- Une banque Belge ? t’es devenu fou ?
- On sera de retour en France avant même qu’ils puissent s’en rendre compte.
- C’est pas deux ans qu’on va prendre, c’est dix. T’en as pas marre d’aller en zonzon.
- Et toi ? T’en as pas marre d’être une merde ? T’as pensé à ta femme… et ta fille ?
Mais on ne s’improvise pas braqueurs de banque en quelques jours. Le coup, une fois de plus était parfait. Trop parfait. Une fois travail effectué, on est rentré bien sagement à la maison, comme si de rien n’était. Franckie nous a déposés devant la maison et on a fait la fête avec nos familles. Sans savoir qu’on s’était fait balancé.
Vers deux heures du matin, Franckie est venu sonner. Il n’était pas seul. Cinq ou six flics se tenaient derrière lui. Depuis le début, il avait vendu la mèche. Un braquage trop parfait.
Quand Christophe a ouvert la porte, j’étais derrière lui, avec la gamine qui dormait dans mes bras. J’ai aperçu le visage du traitre lui annoncer la mauvaise nouvelle enrobée de j’ai pas eu le choix et de je suis désolé.
Christophe l’a attrapé et a essayé de sortir son flingue de son pantalon et les flics on tiré. Franckie s’est pris une balle et moi…
- Déconne pas !
J’oublierai jamais son visage. Il a pointé son arme encore fumante vers moi. J’hésitais à donner la gamine à Marie, qui avait cessé de hurler, de peur qu’ils ne me butent tout aussi froidement que Christophe.
- Suis pas armé.
- Lâche-la et baisse-toi !
J’ai obéi, attendu le dernier souffle de mon ami, en vain, et je me suis fait embarquer, sans oser regarder Marie une dernière fois.
*
J’avais fait mes sept ans de taule, avec comme seul visite les lettres de Tony et les confitures de Célou. Pendant sept ans, j’ai fait le mort. J’ai appris à vivre seul, à souffrir, à encaisser.
J’ai tenté plusieurs fois de joindre Marie, d’avoir des nouvelles de ma fille. J’ai appris qu’elle était partie de Marseille, comme si elle avait fuit cette ville, comme si elle m’avait effacée de sa vie. Elle m’avait prévenue, et je l’avais crue. Alors pourquoi ? J’ai eu tout ce temps pour me poser la question.
Lorsque je suis sorti, j’ai essayé de les retrouver. Elles avaient quitté le sud pour aller se perdre vers Dijon. Je n’ai jamais osé les revoir. Pour ma fille je devais sûrement être mort, remplacé par un meilleur père, un meilleur mari.
Alors j’ai continué de trainer, j’ai bossé dans ce putain de supermarché et Tony est venu me chercher.
Souvent, je les imagine toutes les deux. J’embelli mes souvenirs et je m’invente cette vie perdue. Et lorsque mes rêves rejoignent mes fantasmes, Kaya prends la place de Marie et je m’endors paisiblement.
C’est le téléphone qui m’a réveillé. J’avais du mal à remettre les images dans l’ordre. J’étais chez moi. J’ai regardé le réveil, cinq heures trente deux. J’ai laissé le téléphone sonner, je me suis levé, j’ai pris une gitane dans le paquet sur la table de chevet et je me suis assis sur le balcon, en attendant que le soleil se lève. J’étais seul. Seul avec le sentiment d’avoir fait une grosse connerie.
J’ai attendu les premiers rayons scintillant sur la mer grisâtre pour commencer à penser. Je savais qu’elle ne serait plus là quand je me réveillerai. Histoire de me demander si j’avais oui ou non rêvé. Pour me montrer à quel point j’avais été manipulé. Je ne voulais pas culpabiliser. Je voulais juste rester là, paisiblement, à observer encore une fois la vie s’écouler sans moi. A prendre le temps de comprendre pourquoi. A regarder les ombres de cette nuit que j’avais tant espérée, s’envoler et s’éteindre lentement. Bientôt, je n’aurai plus de souvenir. Et le téléphone qui sonnait sans arrêt, ce matin-là, n’annonçait pas que des bonnes nouvelles. Rien à faire ! Je n’avais pas l’intention de répondre.
*
Les premières basses de Giuliani précédaient la trompette moqueuse de Truffaz. Je commençais à flipper. Je tournais en rond, inondé par les tressaillements des cuivres. Ça grinçait dans ma tête et je désertais le monde qui tentait de me rattraper. Ce putain de téléphone sonnait au rythme de ce qui allait être le début d’un course contre moi-même. Elle, moi, et tous ceux qui nous séparaient.
J’ai rejoins le port vers huit heures. Je me suis installé à une terrasse, un café et un clope m’aideraient sûrement à adoucir cette matinée. Je pensais à Christophe qui se serait bien foutu de ma gueule, crachant sur le tas de merde que j’étais devenu. Ben mon vieux, on est plus très loin tous les deux.
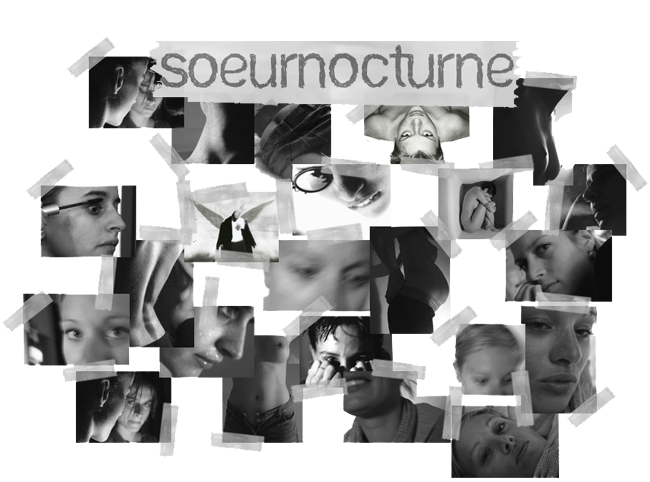







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire